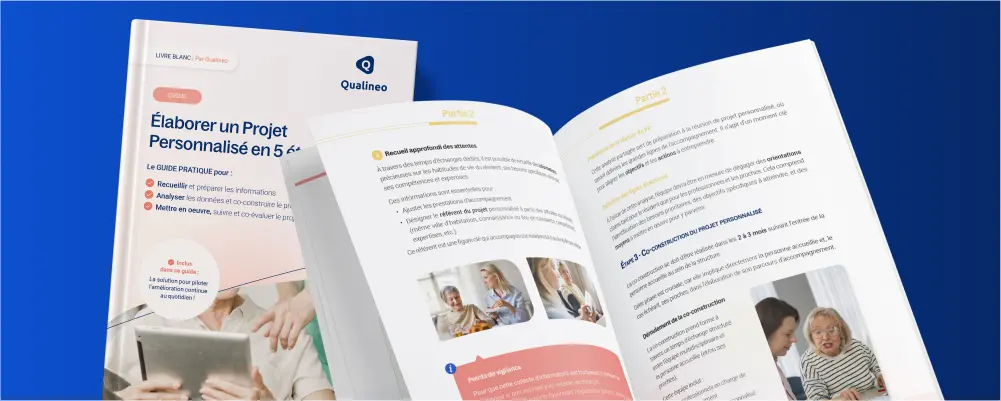8 façons d’encourager la participation à la vie sociale en Ehpad


La participation à la vie sociale en EHPAD est un enjeu central, dans un contexte où les troubles cognitifs touchent un nombre croissant de résidents.
Comment leur permettre de rester pleinement acteurs de leur quotidien, malgré la perte d’autonomie ? Il ne s’agit plus simplement de les consulter, mais de co-construire avec eux un cadre de vie respectueux et stimulant.
Au-delà de la démarche éthique, cette participation est aussi au cœur du référentiel d’évaluation de la HAS, qui en fait une exigence transversale à travers trois chapitres, huit critères et des éléments d’évaluation précis.
Voici des pistes concrètes pour favoriser une participation réelle, inclusive et durable, en lien étroit avec les attendus réglementaires et les pratiques de terrain.
1. Donner la parole… autrement
Certaines personnes ne peuvent plus s’exprimer comme avant. Pour autant, leur silence ne signifie pas absence d’opinion. Il s’agit de :
- Multiplier les temps de parole : groupes de parole, entretiens individuels, conseils informels.
- Utiliser des supports adaptés : photos, objets, musique, pictogrammes.
- Proposer un accompagnement à l’expression : professionnels formés, proches, bénévoles médiateurs.
- Introduire des outils numériques simples (tablettes, bornes interactives) pour recueillir l’avis des résidents sous forme ludique (émoticônes, sondages visuels…).
2. Mieux inclure les personnes atteintes de troubles cognitifs
Même atteints de troubles, les résidents peuvent s’exprimer, ressentir, choisir :
- Créer des ateliers sensoriels pour stimuler la mémoire et l’expression émotionnelle.
- Enregistrer leurs réactions ou propos lors des activités pour les analyser dans le temps.
- Former les professionnels à l’observation fine des micro-comportements pour décoder les préférences.
- Proposer un binôme résident-proche pour représenter leur voix au Conseil de la Vie Sociale (CVS).
3. Représenter ceux qui ne peuvent pas
Pour que le CVS soit réellement représentatif :
- Encourager des candidatures en binôme résident + famille.
- Organiser le remplacement automatique en cas de départ.
- Prévoir un soutien à l’expression lors des réunions CVS.
- Recueillir en amont les préoccupations des proches et les intégrer à l’ordre du jour.
- Inviter régulièrement de nouveaux résidents au CVS pour faciliter leur intégration.
4. Partir du quotidien pour reconstruire du lien
L’implication passe souvent par de “petits riens” concrets :
- Créer des espaces d’expression autour des repas, de l’animation, des moments de vie.
- Associer les résidents aux décisions simples : menus, choix des activités, décoration.
- Valoriser leurs parcours dans un journal ou une rubrique “mémoire vivante” sur le site.
- Prendre en compte leurs préférences en matière de restauration (temps, goût, accompagnement, ambiance sonore).
5. Diversifier les formes de participation
- Identifier les résidents isolés et comprendre leurs freins à la participation.
- Adapter les activités : certains aiment les jeux, d’autres préfèrent raconter leur histoire ou transmettre un savoir-faire.
- Mettre en place des “missions” internes (accueil d’un nouvel arrivant, animation, jardinage…) pour valoriser leurs compétences.
6. Articuler participation et projet d’accompagnement personnalisé (PAP)
- Intégrer la question : “Comment souhaitez-vous contribuer à la vie de l’établissement ?” dans les entretiens du PAP.
- Valoriser les engagements pris (rôle dans une commission, animation d’un atelier).
- Relier ces éléments au projet d’établissement, comme témoins d’une vraie citoyenneté au quotidien.
7. Créer une culture de la participation comme acte de bientraitance
- La participation est un droit, pas une option : elle incarne le respect de la dignité.
- Elle contribue à prévenir le repli sur soi, la perte d’estime, voire la maltraitance passive.
- C’est aussi un indicateur qualitatif valorisé dans l’évaluation HAS, notamment dans les critères liés aux libertés, à l’information, et à l’implication des usagers.
8. Évaluer régulièrement le sentiment d’utilité des résidents
Pourquoi ne pas créer un baromètre du climat social résidentiel ?
- Questions simples et régulières : “Ai-je pu donner mon avis ?”, “Mes idées ont-elles compté ?”, “Ai-je été utile ?”
- Restitution et analyse collective en CVS ou avec l’équipe animation pour ajuster les pratiques.
La participation à la vie sociale dans le référentiel HAS : un fil rouge de l’évaluation
La participation à la vie sociale en EHPAD est au cœur du référentiel d’évaluation de la HAS, structurant la qualité de l’accompagnement au quotidien. Présente dans les trois chapitres du référentiel, elle fait l’objet de 3 objectifs et 8 critères standards, avec des éléments d’évaluation concrets.
La participation sociale des résidents est donc une exigence transversale. Elle ne se limite pas aux animations : elle touche à l’information, au lien, à l’organisation et à l’environnement.
L’évaluation met l’accent sur trois dimensions :
- Ce que vit la personne
- Ce que font les professionnels
- Ce que met en place la structure
Voici comment cela se traduit sur le terrain :
Chapitre 1 — Objectif 1.8 : La personne accompagnée participe à la vie sociale
CRITÈRE 1.8.1 – La personne accompagnée a la possibilité de maintenir ses liens sociaux et d’en créer de nouveaux, dans et hors l’établissement ou le service.
CRITÈRE 1.8.2 – La personne peut s’investir dans la vie sociale et culturelle et participer à des évènements sur le territoire grâce à un accompagnement adapté.
CRITÈRE 1.8.3 – Les professionnels informent la personne accompagnée sur l’offre d’activités sportives, socioculturelles et de loisirs, recueillent ses attentes et respectent ses choix de participation.
CRITÈRE 1.8.4 – Les professionnels identifient et mobilisent les ressources et moyens nécessaires à la mise en place d’activités sportives, socioculturelles et de loisirs.
CRITÈRE 1.8.5 – Les professionnels encouragent le recours à la pair-aidance et autres dispositifs facilitant l’entraide entre les personnes accompagnées.
Les attendus de l’objectif 1.8
Les éléments d’évaluation mettent l’accent sur l’expérience vécue par la personne :
- L’entretien avec le résident est central pour vérifier s’il peut maintenir ses liens sociaux, créer de nouveaux contacts ou encore accéder à la vie culturelle.
- L’évaluation s’appuie aussi sur l’observation d’affichages, de supports d’information, et des traces d’organisation d’évènements internes ou territoriaux.
- Les professionnels sont attendus sur leur capacité à recueillir les attentes, à informer de manière personnalisée, et à mobiliser les ressources nécessaires.
- Le recours à la pair-aidance et aux dispositifs d’entraide entre résidents est également valorisé, notamment à travers l’affichage, les échanges et les documents présents dans le dossier individuel.
Chapitre 2 — Objectif 2.3 : Les professionnels favorisent la participation sociale
CRITÈRE 2.3.1 – Les professionnels favorisent la préservation et le développement des relations sociales et affectives de la personne accompagnée.
CRITÈRE 2.3.2 – Les professionnels soutiennent et/ou orientent la personne accompagnée pour accéder aux services et dispositifs de droit commun.
Les attendus de l’objectif 2.3
Ce chapitre change de point de vue : on évalue ici la posture des professionnels.
- L’évaluation cherche à objectiver leur implication dans le maintien et le développement des relations sociales de la personne accompagnée (famille, amis, autres résidents).
- Les éléments observés porteront sur les espaces de vie, la liberté de circulation, les opportunités de lien affectif.
- Les documents (plans d’accompagnement, fiches de liaison, comptes rendus d’activités) permettent de vérifier que l’accompagnement inclut aussi l’accès aux services de droit commun (bibliothèque, club, transport, événements locaux).
Chapitre 3 — Objectif 3.3 : L’ESSMS facilite la participation sociale
CRITÈRE 3.3.1 – L’ESSMS met à disposition des personnes accompagnées des espaces de rencontre et de socialisation, ainsi que des espaces d’apaisement et de bien-être
Les attendus de l’objectif 3.3
Ce troisième niveau élargit encore la focale : il s’agit d’évaluer l’engagement structurel de l’établissement.
- Le regard porte sur la disponibilité et l’accessibilité des espaces favorisant les rencontres, la détente et le bien-être.
- L’évaluation prend en compte la cohérence de l’approche inclusive de l’ESSMS : stratégie globale, articulation avec le projet d’établissement, implication des parties prenantes.
- L’observation sur site est ici précieuse : qualité des espaces communs, mobilier, confort, ambiance, signalétique…
Cet article sur les 8 façons d’encourager la participation à la vie sociale en Ehpad vous a intéressé.e ? Restez informé.e des actualités de votre secteur en vous abonnant à notre newsletter.