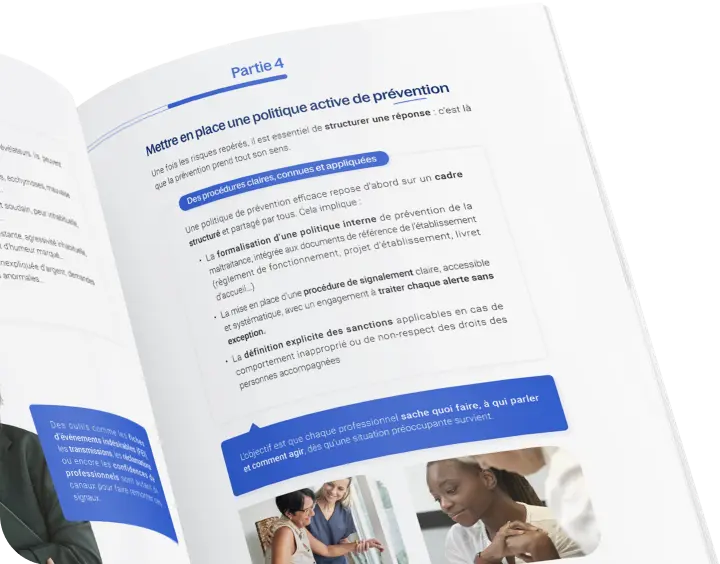Les situations de maltraitance intrafamiliale sur personnes majeures vulnérables sont en nette augmentation, notamment à domicile, où elles restent souvent invisibles.
Les professionnels de proximité (aides à domicile, infirmiers, travailleurs sociaux, coordinateurs) sont souvent les premiers à observer des signes de rupture ou de danger.
Pour les accompagner, la Haute Autorité de Santé a publié en 2024 un guide : Évaluation du risque de maltraitance intrafamiliale sur personnes majeures en situation de vulnérabilité et a organisé un webinar dédié à ce sujet.
Objectif : fournir des repères clairs, des outils pratiques et une méthode d’analyse partagée pour permettre aux professionnels d’agir en sécurité, dans le respect des personnes et du cadre légal.
Cet article en propose une synthèse opérationnelle, pensée pour le terrain.
Comprendre la maltraitance à domicile
Avant de pouvoir repérer ou intervenir, il est essentiel de bien comprendre ce qu’est la maltraitance intrafamiliale et ce qui la distingue d’autres formes de violences ou de conflits familiaux.
Ce n’est pas toujours évident sur le terrain, surtout quand les liens affectifs, la dépendance ou la loyauté familiale brouillent les repères.
Une définition depuis la loi du 7 février 2022
Depuis la loi du 7 février 2022, la maltraitance est définie à l’article L.119-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) comme :
« Tout geste, parole, action ou défaut d’action qui compromet ou porte atteinte au développement, aux droits, aux besoins fondamentaux ou à la santé d’une personne en situation de vulnérabilité, dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d’accompagnement. »
Concrètement, cela signifie que même un silence, un oubli, une négligence peuvent être qualifiés de maltraitance, dès lors qu’ils interviennent dans une relation de soin ou de confiance, comme c’est souvent le cas à domicile.
La maltraitance peut être :
- Intentionnelle ou non
- Ponctuelle ou répétée
- Individuelle, collective ou institutionnelle
Les différentes formes de maltraitance
Les professionnels rencontrent parfois des situations difficiles à nommer. Voici un rappel des formes principales de maltraitance, avec des exemples concrets issus du quotidien :
- Physique : coups, contentions, secousses lors de transferts
- Psychologique : humiliations, menaces, infantilisation, dénigrement
- Sexuelle : gestes déplacés, attouchements, absence de consentement
- Médicale ou médicamenteuse : oubli volontaire de soins, surdosage, absence de traitement
- Matérielle ou financière : détournement d’allocations, vols d’argent, pressions pour signer des chèques
- Par négligence : hygiène non assurée, repas non préparés, isolement prolongé
- Discriminatoire : rejets ou maltraitances liés à l’âge, l’origine, l’orientation sexuelle, le handicap
- Environnement violent : logement insalubre, cris permanents, conflits familiaux non maîtrisés
La maltraitance intrafamiliale : ce qui la rend spécifique
Dans un cadre familial, les repères sont souvent flous. Ce n’est pas un professionnel qui est maltraitant, mais un proche : enfant, conjoint, petit-enfant, frère ou sœur…
Ce contexte particulier crée plusieurs freins au repérage :
- Le huis clos du domicile : la violence se joue sans témoins
- Les loyautés familiales : la victime protège son agresseur
- Le déni : "Ce n’est pas si grave", "C’est mon fils", "Il traverse une mauvaise passe"
- L’emprise : la peur, la dépendance émotionnelle ou économique empêchent d’agir
Trois situations fréquentes à connaître
La HAS identifie trois formes particulièrement fréquentes de maltraitance intrafamiliale à domicile :
- Sur personnes âgées : souvent liées à la négligence, la précarité, ou des aidants dépassés
- Violences conjugales : difficiles à repérer, souvent banalisées, mais lourdes de conséquences
- Parents violentés : des situations méconnues, mais bien réelles, où un enfant (mineur ou majeur) exerce une violence sur son parent
Chacune de ces situations fait l’objet de grilles de repérage spécifiques présentées plus loin dans l’article.
Identifier les situations à risque
Avant même l’apparition de signes visibles, certains profils ou contextes de vie doivent éveiller la vigilance.
Comprendre la vulnérabilité
Il ne s’agit pas seulement d’un handicap ou d’un grand âge. On parle aujourd’hui de “situation de vulnérabilité”, c’est-à-dire quand une personne, même lucide, ne peut plus faire face seule à ses besoins ou à ses droits.
Exemples concrets de situations à risque élevé :
- Une personne âgée dépendante vivant avec un aidant unique (souvent un enfant ou un conjoint)
- Une personne avec des troubles cognitifs ou psychiques (Alzheimer, bipolarité, dépression sévère…)
- Une personne en incapacité de s’exprimer (aphasie, surdité, barrière de la langue)
- Une personne isolée géographiquement ou socialement
À retenir
La vulnérabilité n’est pas une faiblesse, c’est une situation évolutive, souvent contextuelle. Elle doit être prise en compte dans toute évaluation du risque.
Les facteurs de risque : ce qui peut fragiliser ou favoriser une maltraitance
Il ne s’agit pas de juger ou de pointer du doigt. Mais certains éléments de contexte ou de comportement peuvent alerter et méritent d’être croisés avec vos observations :
Chez la personne accompagnée :
- Forte dépendance physique
- Troubles cognitifs ou psychiatriques (Alzheimer, dépression, schizophrénie…)
- Isolement social, repli sur soi, peur du jugement
- Perte d’autonomie soudaine (chute, retour d’hospitalisation, fatigue extrême)
- Discours flous, incohérents ou systématiquement minimisés
Chez l’aidant ou l’entourage :
- Épuisement physique ou mental, surcharge de responsabilités
- Addictions (alcool, médicaments, drogues)
- Problèmes financiers importants, précarité
- Conflits familiaux non résolus, antécédents de violence
- Absence de relais ou de soutien extérieur (pas d’aide pro, pas de famille, pas de repos)
À retenir
Un seul facteur ne suffit pas à conclure à une maltraitance. Mais plusieurs facteurs associés à un contexte de vulnérabilité doivent vous amener à vous poser des questions… et à en parler.
Les moments où le risque augmente : attention aux transitions de vie
Certaines périodes de transition ou de crise sont connues pour déstabiliser les équilibres familiaux et accroître les tensions :
- Retour d’hospitalisation ou de séjour en EHPAD
- Naissance d’un enfant (dans les cas de violences conjugales)
- Décès, séparation, incarcération d’un proche
- Entrée d’un jeune adulte en échec scolaire ou professionnel au domicile parental
- Installation d’un proche “temporaire”… qui dure (souvent dans un contexte financier tendu)
À retenir
En tant qu’intervenant·e, soyez particulièrement attentif·ve à ces moments-là, même si les relations semblaient “normales” jusque-là.
Et si je doute ?
Vous n’avez pas à poser un diagnostic. Votre rôle est d’observer, de documenter, de partager.
Posez-vous ces 3 questions simples :
- Est-ce que cette personne est dans une situation de dépendance ou d’isolement ?
- Est-ce que son entourage semble en difficulté ou en souffrance ?
- Ai-je observé un changement inhabituel (attitude, discours, environnement) ?
Si une ou plusieurs réponses sont “oui”, gardez une trace, alertez votre hiérarchie et échangez avec les autres professionnels si possible.
Repérer les signaux d’alerte sur le terrain
Une phrase qui revient souvent chez les professionnels : « Je sentais que quelque chose n’allait pas, mais je ne savais pas quoi. » C’est exactement là que commence le repérage.
Repérer, ce n’est pas juger, ni enquêter. C’est observer, écouter, sentir et documenter ce que l’on perçoit. Et surtout, oser se faire confiance.
Ce que je vois, ce que j’entends, ce que je ressens
Les signaux d’alerte peuvent être faibles, diffus, voire banalisés. Mais cumulés, ils dessinent une alerte claire. Voici ce qu’il faut regarder et écouter :
Chez la personne accompagnée :
- Apparence négligée, vêtements inadaptés, odeur d’urine, manque d’hygiène
- Plaies inexpliquées, bleus, douleurs somatiques à répétition
- Perte de poids, fatigue, dépression visible
- Discours confus ou incohérent : « Je tombe souvent… », « Je ne veux pas déranger… »
- Anxiété, agitation, peur excessive d’un membre de la famille
- Justification excessive : « Il fait de son mieux… » même quand la situation est critique
Dans la relation avec l’aidant ou un proche :
- Présence intrusive lors des visites : la personne n’est jamais seule
- L’aidant parle à la place de la personne
- Ton condescendant ou agressif, gestes brusques
- Tensions perceptibles, silences pesants
- Contrôle de l’argent, des déplacements, des décisions
Dans le logement ou l’environnement :
- Maison froide, sombre, encombrée ou sale
- Aliments périmés, pas de repas préparé
- Animaux nombreux ou maltraités
- Objets cassés, traces de coups sur les murs ou portes
- Absence de matériel médical pourtant prescrit
Des signes chez l’aidant ? C’est aussi un indicateur
Beaucoup de maltraitances sont liées à un épuisement, une perte de repères, ou une détresse chez l’aidant. Il peut lui aussi être en souffrance.
Soyez attentif à :
- Un proche qui semble à bout, déprimé, sur la défensive
- Un refus d’aide extérieure
- Une consommation visible d’alcool, médicaments
- Un discours du type : « Je n’en peux plus », « Elle fait exprès », « C’est moi qui fais tout »
Bon à savoir
Un aidant maltraitant n’est pas forcément malveillant. Il peut être isolé, dépassé, ou lui-même fragilisé.
Que faire selon le niveau de vigilance ?
🔵 Signes faibles : je reste attentif·ve, j’observe l’évolution de la situation, je prends des notes objectives et régulières
🟠 Signes cumulés : j’en parle à mon responsable, à mon coordinateur·rice ou à l’équipe si possible, pour partager mes observations
🔺 Signe rouge (danger avéré ou imminent) : je signale immédiatement la situation ou je fais appel à un relais compétent (médecin, service social, autorités)
Exemple de signe rouge : un hématome non expliqué, une personne terrorisée, une plainte directe, une mise en danger physique.
Retrouvez les 3 grilles de repérage de la HAS ici :
⦿ Maltraitance sur personnes âgées – Grille de repérage
⦿ Violences conjugales – Grille de repérage
⦿ Parents violentés – Grille de repérage
Et si la personne nie ou minimise ?
C’est fréquent. La personne peut :
- avoir honte
- craindre des représailles
- être sous emprise
- ou ne pas se reconnaître comme victime.
Dans ce cas :
- Ne pas forcer
- Montrer que vous êtes là, en confiance
- Noter objectivement ce que vous observez
- Créer un lien de confiance, ça prend du temps… mais c’est souvent décisif.
Quelques réflexes simples à adopter
✔ Laisser toujours la porte ouverte au dialogue
✔ Proposer un moment en tête-à-tête
✔ Poser des questions ouvertes : « Comment ça se passe avec votre fils ? », « Est-ce que vous vous sentez en sécurité ici ? »
✔ Utiliser le “je” : « Je suis un peu inquiet de ce que j’ai vu/entendu »
À retenir
Si vous avez un doute, ce doute est déjà un indice. Parlez-en, partagez avec vos collègues ou responsables. Vous n’êtes pas seul.e. D’autres professionnels peuvent vous aider à évaluer, à faire le lien ou à signaler si nécessaire.