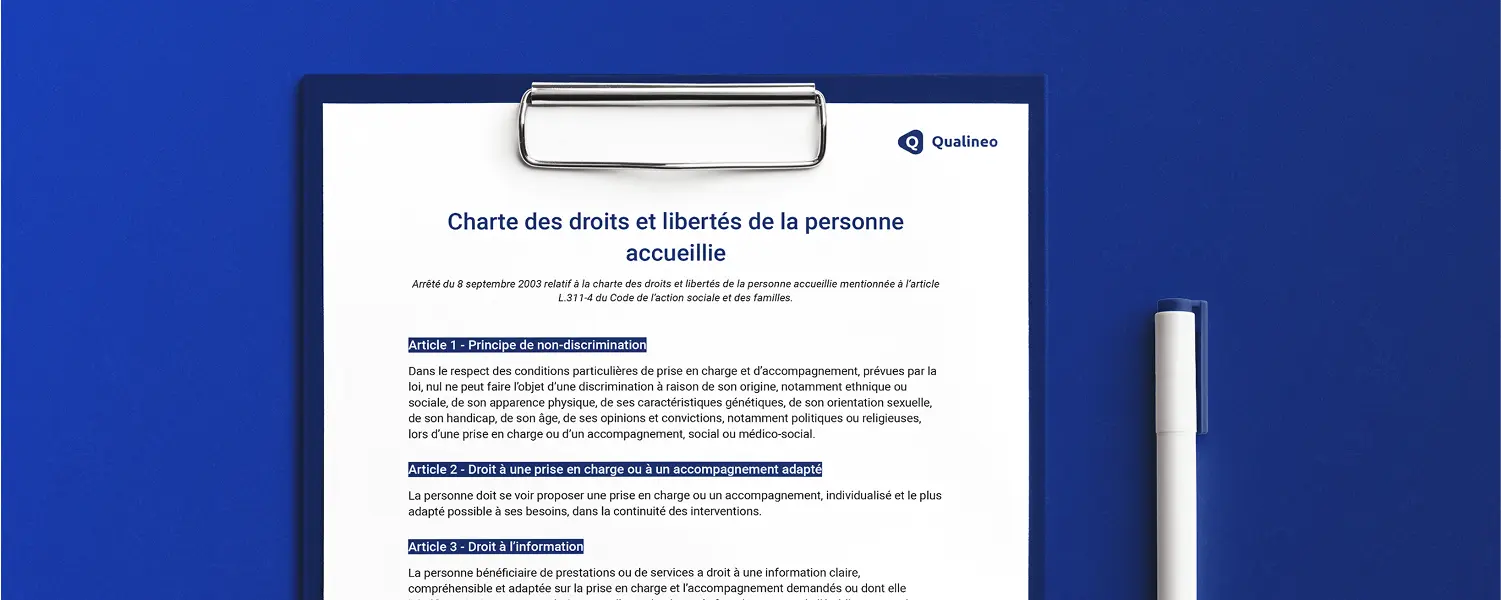Contention en santé : définition, cadre légal, pratiques et responsabilités


En établissement de santé et en médico-social, la contention suscite des questions récurrentes : quand y recourir ? selon quelles règles ? avec quels risques pour la personne et pour les professionnels ?
Cet article propose un décryptage de la contention : sa définition, son cadre légal, les conditions de mise en œuvre ainsi que les solutions alternatives à privilégier avant toute restriction.
Il aborde également les responsabilités professionnelles et juridiques en cas d’usage inadapté, pour accompagner les équipes dans une démarche à la fois sûre, éthique et conforme.
Cet article a été validé et enrichi par Anne-Sophie Moutier juriste, formatrice, Consultante spécialisée en droit de la santé et médicosocial.
Qu’est-ce que la contention en santé ?
En établissement de santé comme en ESSMS, la contention désigne l’ensemble des moyens utilisés pour limiter volontairement les mouvements d’une personne lorsque son comportement représente un danger pour elle-même ou pour autrui.
Une pratique encadrée, exceptionnelle et toujours à visée thérapeutique.
Définition de la Haute Autorité de Santé
Selon la HAS, la contention correspond à :
« l’utilisation de tous moyens, méthodes, matériels ou vêtements visant à limiter les capacités de mobilisation d’un individu afin de le sécuriser ou de protéger son environnement ».
Autrement dit, il s’agit d’une mesure de dernier recours, qui ne peut intervenir qu’après l’échec de toutes les autres approches relationnelles, environnementales ou médicamenteuses. Elle doit être évaluée en équipe pluridisciplinaire, prescrite par un médecin, justifiée, tracée dans le dossier du patient et régulièrement réévaluée.
Les différents types de contention
La contention peut prendre plusieurs formes selon le contexte de soins :
La contention physique ou mécanique :
Utilisation d’un dispositif pour empêcher un mouvement (par exemple, ceinture ventrale, sangles, attaches de poignets ou barrières de lit). Elle doit toujours être adaptée, sécurisée et installée de manière à préserver le confort, la dignité et la sécurité de la personne.
La contention chimique :
Recours à un médicament (neuroleptique, sédatif, anxiolytique…) pour réduire un comportement jugé dangereux ou agité. Cette modalité, bien que courante, est soumise aux mêmes exigences de justification et de suivi médical.
La contention environnementale :
Limitation des déplacements par des aménagements matériels (service fermé, chambre verrouillée, espace sécurisé). Ce type de mesure peut être mis en place pour des raisons de sécurité, mais il doit être évalué comme une restriction à la liberté d’aller et venir.
À ne pas confondre
Certaines pratiques ne relèvent pas à proprement parler de la contention :
- La contention posturale, utilisée en rééducation pour maintenir une posture correcte
- La contention active, employée par les kinésithérapeutes pour favoriser la verticalisation après alitement.
Ces approches thérapeutiques ont une finalité de soin et ne visent pas à restreindre la liberté de la personne.
Le cadre légal et réglementaire : une pratique faiblement encadrée
En dehors de la psychiatrie, la mise en œuvre d’une contention est faiblement encadrée par la loi et par les recommandations nationales. Cependant, l’objectif est double : garantir la sécurité du patient tout en protégeant ses droits fondamentaux : dignité, intégrité, liberté d’aller et venir. La jurisprudence y est particulièrement attentive.
Un principe fondateur : la dignité de la personne
Principe protégé constitutionnellement par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, le principe de la liberté d’aller et venir rejoint le principe de dignité de la personne.
La Charte des droits et libertés de la personne accueillie et la Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante rappellent que “nul ne peut être privé de sa liberté de mouvement sans justification médicale et proportionnée”
Autrement dit, la contention ne peut jamais être utilisée comme mesure de confort, de punition ou de compensation d’un manque de personnel.
Une base légale en EHPAD depuis la loi du 28 décembre 2015
En pratique
La loi fixe le cadre, mais c’est la culture professionnelle qui fait la différence. Respecter la procédure, documenter chaque étape et travailler en équipe sont les clés pour concilier sécurité, bientraitance et conformité réglementaire.
Quand la contention peut-elle être justifiée ?
La contention ne doit jamais être considérée comme une réponse réflexe à un comportement jugé « difficile ». Elle n’a de sens que lorsqu’un danger immédiat ou imminent menace la personne ou autrui et que toutes les autres solutions ont échoué. C’est une décision médicale et éthique qui s’appuie sur une évaluation pluridisciplinaire.
Les situations dans lesquelles la contention peut être envisagée
Les indications reconnues concernent un nombre limité de situations :
- État d’agitation, d’agressivité ou de confusion aiguë mettant en danger la sécurité de la personne ou d’autrui.
- Risque majeur de chute ou de blessure lié à des troubles moteurs, cognitifs ou comportementaux sévères.
- Comportements auto-agressifs ou hétéro-agressifs lorsque le danger est immédiat et qu’aucune autre mesure ne permet de prévenir le risque.
Dans ces contextes, la contention peut être temporairement justifiée, à condition d’être :
- proportionnée à la situation
- accompagnée d’une surveillance renforcée
- réévaluée dès que l’état du patient le permet.
Les cas où la contention n’est pas justifiée
Certaines pratiques constituent des dérives :
- Utiliser la contention pour gagner du temps ou pallier un manque de personnel
- Maintenir une contention par « habitude » sans réévaluation médicale
- Contenir pour éviter un contentieux judiciaire (ex. : peur d’une chute).
Ces situations sont contraires aux recommandations de la HAS et peuvent être qualifiées de maltraitance.
Les contre-indications médicales
La contention peut aggraver certains troubles physiques, elle doit donc être proscrite ou adaptée en cas de :
- Insuffisance cardiaque
- Troubles respiratoires ou infectieux
- Troubles neurologiques ou métaboliques
- Atteintes orthopédiques
- État clinique fragile rendant l’immobilisation risquée
Le médecin doit toujours évaluer le rapport bénéfice/risque en lien avec l’équipe : parfois, ne pas contenir expose à un danger plus grave que la contention elle-même ; parfois, c’est l’inverse.
Une décision collégiale
La décision de mise en place d’une contention doit être prise en équipe pluridisciplinaire, associant le médecin, les soignants et, dans la mesure du possible, le patient et sa famille. Ce dialogue permet de :
- Assurer la compréhension et l’adhésion de tous
- Prévenir les malentendus
- Faciliter la levée de la contention dès que possible.
À retenir
La contention ne peut être ni systématique, ni préventive, ni de confort. Elle ne se justifie que dans des cas exceptionnels, après analyse collective et toujours pour protéger sans nuire. Chaque mesure doit rester temporaire, surveillée et documentée.
Alternatives à la contention : prévenir avant de restreindre
Avant d’envisager toute mesure de contention, il est indispensable de chercher les causes du comportement et d’identifier des solutions moins restrictives.
Cette recherche d’alternatives s’inscrit dans une démarche de prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance, valeurs fondamentales dans les établissements de santé et médico-sociaux.
Comprendre avant d’agir
Les comportements d’agitation, de refus ou de déambulation traduisent souvent un besoin non satisfait plutôt qu’un trouble du comportement. Ils peuvent être liés à une douleur, une incompréhension, un manque de repères, ou encore à un sentiment d’abandon.
Observer, écouter et analyser avant d’intervenir, c’est déjà prévenir la contention.
10 alternatives à la contention en EHPAD à expérimenter
Ces alternatives, issues de la pratique et des recommandations, sont particulièrement adaptées au secteur médico-social (EHPAD, MAS, FAM, IME…) où la personnalisation de l’accompagnement et le travail d’équipe permettent d’agir autrement que par la contrainte.
1. Identifier et traiter les causes médicales
Douleur, infection, déshydratation, effets secondaires de médicaments… agir sur la cause première réduit souvent l’agitation.
2. Corriger les déficits sensoriels
Vérifier que la personne dispose de ses lunettes, prothèses auditives ou tout autre dispositif compensatoire.
3. Adapter l’environnement matériel
Rabaisser le lit, retirer les obstacles, installer un tapis de sol, ajuster l’éclairage et réduire les sources de bruit.
4. Aménager les espaces de circulation
Créer des parcours sécurisés, visibles et accessibles, avec des repères visuels rassurants.
5. Préserver les repères personnels
Favoriser la présence d’objets familiers, de photos, de vêtements personnels pour maintenir un sentiment de continuité et d’apaisement.
6. Favoriser la mobilité accompagnée
Proposer des aides techniques adaptées (déambulateur, fauteuil ergonomique), encourager la marche encadrée plutôt que la restriction.
7. Proposer des activités adaptées
Occuper l’esprit et les mains : ateliers thérapeutiques, stimulation cognitive, activités sensorielles ou musicales selon les capacités.
8. Maintenir la communication et le lien social
Dialoguer, rassurer, impliquer la famille et les proches. La présence humaine reste souvent la meilleure prévention contre l’agitation.
9. Créer un climat apaisant
Diminuer les sources de stress (bruit, agitation du service), instaurer des routines et un environnement rassurant.
10. Observer et réévaluer collectivement
Analyser les situations en équipe pluridisciplinaire, partager les observations et ajuster les pratiques pour éviter la répétition des situations à risque.
Une démarche d’équipe et de culture
Réduire le recours à la contention repose sur une dynamique collective : chacun, du médecin à l’aide-soignant, peut proposer et mettre en œuvre des alternatives adaptées. Cette approche encourage la réflexion éthique, l’innovation dans les pratiques et renforce la qualité du soin au quotidien.
Les bonnes pratiques de mise en œuvre selon la HAS
Lorsqu’une contention est décidée, elle doit être mise en œuvre avec rigueur, transparence et discernement. La Haute Autorité de Santé (HAS) a défini 10 critères de qualité qui encadrent cette pratique et visent à protéger à la fois la personne accompagnée et les professionnels.
Ces repères constituent une référence commune pour garantir une démarche éthique et sécurisée, inscrite dans le respect du droit et de la bientraitance.
1. Une prescription médicale obligatoire
Aucune contention ne peut être appliquée sans prescription médicale écrite, datée et motivée. La prescription doit préciser :
- Les motifs de la contention
- Sa durée prévisible
- Le type de dispositif utilisé
- Le programme de surveillance associé.
En cas d’urgence, la mise en œuvre peut être initiée par un infirmier, mais doit être confirmée par un médecin dès que possible.
2. Une évaluation collégiale du rapport bénéfice/risque
La décision de contention s’appuie sur une concertation pluridisciplinaire : médecin, infirmiers, soignants, éventuellement psychologue ou cadre. Cette réflexion collective limite les dérives et permet d’ajuster la mesure à la situation clinique.
3. Une surveillance programmée et tracée
La surveillance de la personne contenue doit être régulière, planifiée et documentée.
Elle inclut le contrôle du confort, de la position, de l’état cutané, de la respiration, de la nutrition, de l’hydratation et du bien-être psychologique. Chaque observation est consignée dans le dossier patient.
4. Une information claire au patient et à ses proches
Le patient, dans la mesure de ses capacités, ainsi que ses proches, doivent être informés des raisons et des modalités de la contention. Cette transparence favorise la compréhension, évite les malentendus et contribue à maintenir une relation de confiance.
5. Un matériel adapté et sécurisé
Le matériel doit être approprié à la situation, conforme aux normes et en bon état. Il doit garantir la sécurité du patient tout en limitant la contrainte et en préservant le confort et la dignité.
6. Le respect de l’intimité et de la dignité
Toute mesure de contention doit être appliquée dans le respect de la pudeur et de la vie privée. La personne doit rester couverte, installée confortablement et à l’abri des regards.
7. Une levée dès que possible
La contention doit être limitée dans le temps et levée dès que la situation le permet sur avis médical. Chaque levée (totale ou partielle) doit être tracée et évaluée par l’équipe.
8. Le maintien du lien et du confort psychologique
Être contenu ne doit pas signifier être isolé. Le patient doit continuer à bénéficier d’un accompagnement relationnel, d’activités adaptées et de temps d’échange pour prévenir l’anxiété ou la confusion.
9. Une réévaluation quotidienne
En EHPAD, le médecin et l’équipe soignante doivent réévaluer le rapport bénéfice/risque et décider du maintien ou de la levée de la contention. Cette évaluation doit être tracée dans le dossier de soins. Le défenseur des droits, dans son rapport de 2023, préconise une réévaluation tous les 6 mois.
10. Une reconduction uniquement sur prescription motivée
Aucune contention ne peut être prolongée sans nouvelle prescription médicale écrite et justifiée. Chaque reconduction doit être motivée par l’état clinique du patient ou de la personne accompagnée et discutée collectivement.
Bibliographie HAS et de l’ASNM sur la contention :
⦿ Recommandations HAS - Isolement et contention en psychiatrie générale
⦿ Recommandation HAS - Contention physique de la personne âgée
⦿ ANSM - Recommandations pour assurer la sécurité des patients nécessitant une contention médicale
Les risques liés à la contention : pour le patient et les soignants
Même lorsqu’elle est décidée dans un objectif de protection, la contention n’est jamais dénuée de risques. Elle peut entraîner des conséquences physiques, psychiques et organisationnelles parfois graves, aussi bien pour la personne concernée que pour les professionnels qui la mettent en œuvre.
Connaître ces risques, c’est la première étape pour les prévenir et limiter les dérives.
Les risques pour la personne accompagnée
Risques physiques
L’immobilisation prolongée, quelle qu’en soit la forme, expose la personne à de nombreuses complications :
- Syndrome d’immobilisation : perte musculaire, raideurs, escarres, déconditionnement physique
- Troubles circulatoires et thromboemboliques : œdèmes, hypotension orthostatique, phlébite
- Troubles respiratoires et infectieux : stase bronchique, risque de fausse route, infections pulmonaires ou urinaires
- Atteintes cutanées : macération, érythème, lésions de pression, escarres
- Troubles digestifs : constipation, incontinence, perte d’appétit
- Risque de chute aggravé lors de la levée brutale d’une contention ou d’un déplacement non accompagné.
Même une contention chimique (sédatifs, neuroleptiques) peut provoquer des effets indésirables : somnolence, troubles de la marche, chutes, confusion ou aggravation de la désorientation.
Risques psychiques
Au-delà du corps, la contention atteint souvent la dimension psychologique et identitaire :
- Sentiment d’enfermement, d’humiliation ou de perte de contrôle
- Anxiété, agitation accrue, repli sur soi
- Altération de l’estime de soi et du lien de confiance avec les soignants.
Ces effets peuvent renforcer le comportement initial et créer un cercle vicieux : plus la personne est contenue, plus elle se désoriente ou s’angoisse.
Les répercussions pour les proches
La contention est aussi éprouvante pour les familles, qui peuvent ressentir impuissance, culpabilité ou incompréhension face à une mesure vécue comme une atteinte à la dignité.
Un accompagnement et une communication transparente sont indispensables pour prévenir ces sentiments et maintenir la confiance.
Les impacts pour les professionnels
Pour les équipes, la mise en œuvre d’une contention peut générer :
- un sentiment d’échec professionnel ou de culpabilité
- une tension éthique entre sécurité et respect de la personne
- une surcharge de travail liée à la surveillance et à la traçabilité renforcées
- un risque juridique accru en cas de non-respect des protocoles ou d’incident.
À long terme, ces situations peuvent fragiliser la cohésion d’équipe et détériorer le climat de travail.
Responsabilités et sanctions en cas de contention abusive
La contention engage directement la responsabilité du professionnel et de l’établissement. Lorsqu’elle est pratiquée sans justification médicale, sans traçabilité, ou en dehors du cadre légal, elle peut être assimilée à un acte de maltraitance ou à une violation des droits fondamentaux.
Les conséquences peuvent être graves, tant sur le plan juridique que disciplinaire.
La responsabilité médicale et soignante
La prescription d’une mesure de contention relève exclusivement du médecin. Toute décision prise sans avis médical peut constituer un exercice illégal de la médecine, passible de :
- 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende (article L.4161-5 du Code de la santé publique).
En cas d’urgence, l’infirmier peut initier la mesure, mais le médecin doit la confirmer a posteriori. L’équipe doit alors documenter précisément la décision et sa surveillance pour se protéger en cas de contrôle ou de litige.
Les infractions pénales possibles
Une contention mise en œuvre de manière inappropriée ou brutale peut être qualifiée de violence volontaire, notamment si elle entraîne des blessures ou un décès.
Les sanctions sont précisées dans le Code pénal (articles 222-7 à 222-13)et varient selon la gravité des faits :
- jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende en cas d’incapacité supérieure à 8 jours
- jusqu’à 20 ans de réclusion si la contention a entraîné la mort sans intention de la donner.
Bon à savoir
Les juridictions rappellent régulièrement que le risque de chute ne justifie pas une contention abusive : il vaut mieux une surveillance renforcée qu’une atteinte illégale à la liberté d’aller et venir.
La responsabilité de l’établissement
L’établissement est également tenu à une obligation de vigilance et de moyens. Il doit :
- Garantir la conformité des protocoles internes
- Assurer la formation et la sensibilisation des équipes
- Tenir à jour le registre des contentions
- Veiller à ce que chaque mesure soit prescrite, tracée et réévaluée.
En cas de manquement (absence de surveillance, matériel inadapté, non-respect du protocole), sa responsabilité civile ou administrative peut être engagée, entraînant des indemnisations importantes.
Les sanctions disciplinaires et professionnelles
Au-delà du plan pénal, les professionnels peuvent être sanctionnés par leur ordre professionnel (médecins, infirmiers, etc.) en cas de faute déontologique.
Les peines vont :
- de l’avertissement ou du blâme
- à l’interdiction temporaire d’exercice
- voire à la radiation du tableau de l’Ordre en cas de faute grave ou de maltraitance avérée.
Sur le plan du droit du travail, un salarié (infirmier, aide-soignant…) peut être licencié pour faute grave s’il pratique une contention sans prescription, sans traçabilité, ou de manière inappropriée.
Cet article sur la contention vous a intéressé.e ? Restez informé.e des actualités de votre secteur en vous abonnant à notre newsletter